L'Orientale
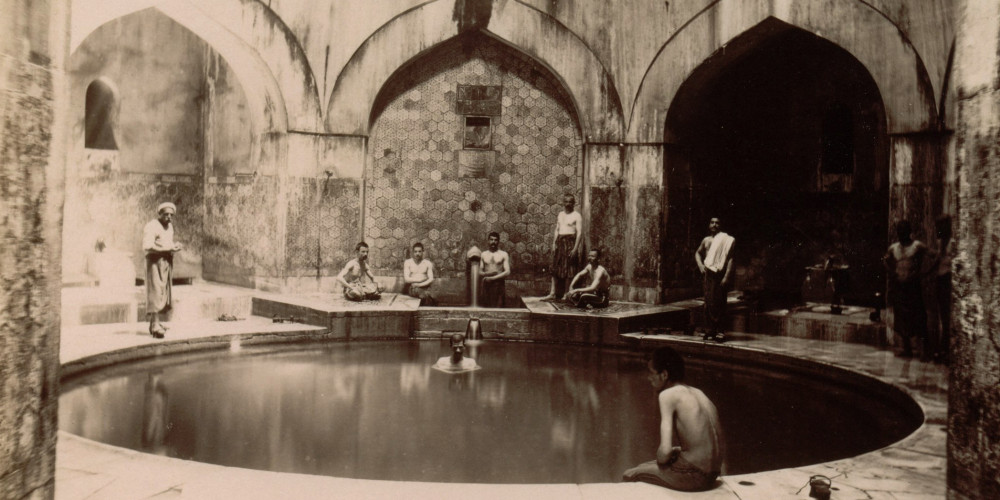
© Bibliothèque nationale de France
Ce rêve de luxe et de volupté mêlés inspire aux artistes des œuvres fortes et épicées, où la femme orientale – odalisque, houri ou almée – occupe la place d'une muse d'un genre nouveau, inspiratrice non de l'amour mais du désir. Odalisques de Delacroix, Orientales de Hugo, baigneuses d'Ingres, Ottomane amoureuse de Loti.
L'icône orientale circule et conforte ses traits, dans un échange incessant entre littérature et peinture. En témoigne, entre autres, la dédicace de Balzac, « À Eugène Delacroix, peintre », pour son roman La Fille aux yeux d'or. Mais ces beautés orientales ne s'offrent pas à une lecture univoque. Leur sensualité oscille, avec ambiguïté, entre volupté et cruauté (pensons à Judith décapitant Holopherne !). Leur apparition est soumise à des tensions paradoxales : dévoilées dans une civilisation du voile ; offertes à la vue, mais enfermées dans des lieux soustraits aux regards ; femmes maîtresses, en attente du maître. Toutes ces contradictions entrent ainsi dans la définition d'un regard occidental, plus marqué par ce qu'il a « vu » de l'Orient, dans son rêve, que de ce qu'il a réellement visité.

© Bibliothèque nationale de France

Femmes musulmanes syriennes à Beyrouth
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
Au-delà, sans doute l'Orient constitue-t-il une contre-épreuve de la réalité occidentale. À la société bourgeoise du 19e siècle qui s'épanouit dans une atmosphère de libéralisme pragmatique, normalisant les rapports entre les sexes, les artistes opposent ainsi un espace ouvert à toutes les rêveries condamnées, à toutes les tentations d'une sensualité interdite.
L'Orient au féminin – cet Orient fait femme – révèle ainsi, plus profondément, un Orient intérieur, une sorte d'« inconscient » avant l'heure de l'homme blanc, partagé, à l'heure de la conquête coloniale, entre fascination et appréhension.
