-
 Album
AlbumLes ukiyo-e, images du monde flottant
-
 Article
ArticleL’apparition de l’ukiyo-e à l’époque d’Edo
-
 Article
ArticleLa technique de l’estampe japonaise
-
 Article
ArticleReprésenter le théâtre et le sumô
-
 Article
ArticleBeautés féminines et vie quotidienne dans les ukiyo-e
-
 Article
ArticleEstampes parodiques, poèmes et surimono
-
![Estampe sans titre [La femme jalouse à la boule de neige]](https://cdn.essentiels.bnf.fr/media/images/cache/crop/rc/B5mTFPG6/uploads/media/image/20201204233956000000_076.jpg) Article
ArticleLes estampes érotiques japonaises
-
 Album
AlbumLes Trente-six vues du mont Fuji par Hokusai
-
 Article
ArticleL’avènement de l’estampe de paysage au 19e siècle
-
 Article
ArticleLes estampes japonaises à la BnF
-
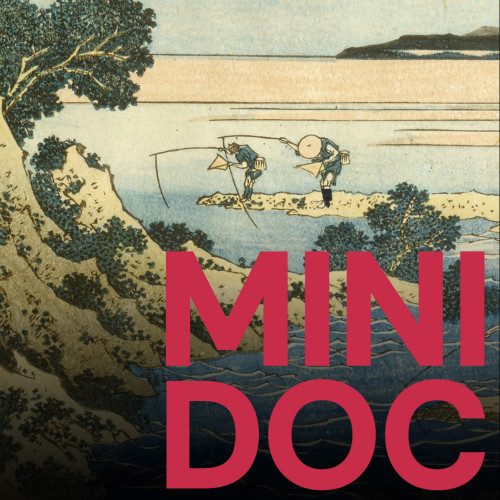 Vidéo
VidéoUn monde flottant
L’apparition de l’ukiyo-e à l’époque d’Edo

© Bibliothèque nationale de France
« En allant admirer les glycines de Kameido »
Quarante-six personnages élégants, hommes, femmes et enfants, se promènent sous une tonnelle de glycines, dont la floraison a lieu au printemps. Les activités festives et les divertissements des Japonais sont souvent liés à la nature et aux saisons (cerisiers en fleurs, fête des iris, fête des chrysanthèmes, des étoiles, de la lune).
Cette procession, que l’on devine discontinue à droite, est animée par des conversations suggérées par les attitudes et les gestes des promeneurs. Dans la scène centrale, un homme porte un sambô, plateau utilisé pour les offrandes votives, sur lequel est inscrit le chiffre 1.
Shunchô s’est plu à représenter ce lieu de promenade attrayant, assuré de séduire une clientèle qui conserverait, par l’image, le souvenir d’un de ses loisirs saisonniers.
Mais c’est aussi un véritable défilé de mode printanière offert aux amateurs d’une manière plaisante. L’artiste rythme la composition, qui se déroule horizontalement, à l’imitation d’un rouleau, par les dimensions des figures, les couleurs, les ombrelles, les motifs des kimonos et obi. De plus, il est sensible aux nuances sourdes imposées par la loi et en joue avec talent.
En effet, dans la seconde moitié du 18e siècle, le luxe fut réprimé et cela eut des incidences décoratives et stylistiques sur les motifs des soieries et des kimonos. Il fut de bon ton de porter des vêtements unis, aux couleurs sobres, à rayures ou à motifs géométriques. L’attention se porta sur les revers des sous-vêtements et des manches, la largeur du obi, autant de détails qui permirent de souligner et de rehausser la simplicité des costumes par des correspondances subtiles de couleurs et de lignes. L’élégance discrète devint le critère de la distinction et du bon goût. (G. L.)
Élève de Shunshô, Katsukawa Shunchô fit partie comme lui de l’école Katsukawa, spécialisée dans les représentations de yakusha-e. Très sensible à la beauté féminine, il se tourna vers les bijin-ga et se rapprocha du style de Kiyonaga, son contemporain, tout en se singularisant. Il n’idéalise pas autant ses modèles.
Ces diptyques, triptyques et pentaptyques d’ôban sont des chefs-d’œuvre du genre.
L’utilisation d’une gamme restreinte de couleurs délicates, conforme aux lois somptuaires promulguées entre 1787 et 1793, maniée avec un sens aigu de l’harmonie et de la lumière, confère à ses œuvres une douceur et une subtilité très poétique.
© Bibliothèque nationale de France
Le Japon à l’époque d’Edo (1603-1868)
L’époque d’Edo correspond au gouvernement des Tokugawa, qui siégea pendant plus de deux siècles et demi. Après d’interminables guerres civiles entretenues par des clans rivaux, et des soulèvements politiques, à la fin du 16e et au début du 17e siècle, Ieyasu Tokugawa reçut, en 1603, le titre de shogun (généralissime), de l’empereur, qui résidait à Kyôto, capitale administrative du pays jusqu’en 1868. Il instaura un gouvernement militaire (bakufu), siégeant à Edo, et exerça son pouvoir sur 270 daimyô, seigneurs de domaines provinciaux. La succession héréditaire assura une stabilité politique au pays, qui connut, dans l’ensemble, une période de paix et de prospérité économique, accompagnée d’un bouleversement culturel.
Le shogun isola le pays du monde extérieur en interdisant tout commerce et tout échange avec les étrangers. Ceux qui résidaient dans l’archipel furent expulsés. Seuls les marchands chinois et les Hollandais, qui pouvaient aborder au port de Nagasaki, dans l’îlot de Deshima, furent tolérés, alors que les Portugais avaient été rejetés dès 1639.
Une idéologie fut imposée au pays, basée sur une hiérarchie de la société, divisée en classes. Les daimyô, grands feudataires, vivaient luxueusement avec leur suite et leur domesticité ; les guerriers (samouraïs), d’origine noble ou paysanne, avaient le privilège de porter le sabre et constituaient l’armée privée du seigneur. Leur code moral était basé sur l’honneur ; les paysans, producteurs de riz et de saké (alcool produit par la fermentation des grains de riz), étaient respectés, tout comme les artisans, créateurs d’objets et d’accessoires de luxe. Quant aux marchands (commerçants et industriels), dont les plus prospères vendaient les étoffes luxueuses et le saké, ils étaient méprisés. Les artistes, les poètes, les acteurs, les courtisanes et les classes sociales de basses conditions représentaient les marginaux.
Une discipline sévère fut imposée. Les daimyô, dès 1635, durent séjourner à Edo une année sur deux, ce qui occasionna de longs trajets des domaines provinciaux vers la capitale shogunale. Ils se déplaçaient en grande pompe et des cortèges sillonnaient le pays, développant de nombreuses activités tout au long du parcours (auberges, maisons de thé, commerce, relais de chevaux). Arrivés dans la capitale, ils constituaient une clientèle fortunée pour les artisans et les marchands. Les samouraïs le plus souvent sans activité guerrière, accompagnaient le seigneur. Les paysans demeuraient sur leur terre.
Une effervescence urbaine
Trois grandes villes connurent un essor considérable, avec une population dense. Edo, parmi les villes les plus peuplées du monde, atteignit plus d’un million d’habitants au 17e siècle, Kyôto 500 000 et Ôsaka 350 000. Les marchands s’enrichirent, alors que les daimyô, habitués à un train de vie dispendieux, virent leur fortune décroître et s’endettèrent au profit des commerçants. L’alphabétisation du grand public s’accrut, sous l’influence des riches marchands, grâce aux écoles des temples, où les moines dispensaient un enseignement.
Cette population urbaine en pleine effervescence, avide de divertissements et bientôt de culture, créa ses lieux de plaisirs, ses spectacles, sa littérature, sa poésie. Les marchands et propriétaires de théâtres recherchaient un média comme support publicitaire et les citadins (chônin), un moyen de conserver le souvenir de leurs loisirs et de leurs idoles. Tous les facteurs étaient réunis pour que des arts nouveaux prennent leur essor, libérés des traditions et du monde féodal. Dès le dernier quart du 17e siècle, l’estampe ukiyo-e, image multiple, bon marché, permettant une grande diffusion, en fut l’un des plus surprenants et fascinants, favorisée de plus par une certaine liberté d’expression accordée par le shogunat. Celui-ci, cependant, pour lutter contre tout excès, promulguait de nombreux édits et des lois somptuaires, sur les modes de vie du chônin, la tenue, le vêtement, le luxe, excessif jusque dans l’art. Un cachet de censure fut apposé sur la plupart des gravures de 1790 jusqu’au début de la période Meiji.

« Feux d’artifice dans la fraîcheur du soir au pont de Ryôgoku à Edo » (Edo Ryôgoku-bashi yûsuzumi hanabi no zu)
En juillet de chaque année, des feux d’artifice sont tirés à Edo, au-dessus du pont de Ryôgoku pour fêter « l’ouverture » nocturne du fleuve Sumida à la navigation des bateaux de plaisance. Reliant les rives orientale et occidentale de la Sumida, à la frontière de deux anciennes provinces, le pont, qui prit le nom de « Pont des deux provinces », rythme ici la composition selon une diagonale qui sépare la rivière, dans la partie supérieure, de l’activité commerçante, dans la partie inférieure de l’estampe. Depuis le pont, les promeneurs contemplent le spectacle de ces feux, le scintillement des fusées et des petites sphères lumineuses animant ce ciel d’été. Dans les rues, une foule bigarrée circule entre les échoppes foraines, les étalages, les maisons de thé, les divertissements musicaux et théâtraux ; ces derniers sont évoqués par le mon (blason) des acteurs Sawamura, représenté sur la gauche, à côté d’une tour d’incendie.
Cette impression, qui date de 1830 environ, est un retirage d’une estampe datant des années 1787-1790 ; quelques modifications ont été apportées sur les couleurs (avec une dominante de bleu de Prusse) et les motifs (la lune qui apparaissait dans l’angle supérieur droit a été remplacée par les inscriptions). (J. B.)
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
Des quartiers réservés
Des quartiers réservés (kuruwa) s’étaient constitués dans les grandes villes : à Kyôto, dès 1589 ; à Ôsaka, au début de 1632 ; à Edo, dès 1617. Dans la capitale shogunale, deux pôles d’attraction se développèrent, le quartier des théâtres et le quartier des plaisirs, le Yoshiwara. Acteurs et courtisanes y connaissaient le succès. Tous ces attraits, éphémères, liés au talent, à la beauté et aux divertissements, se prolongèrent dans les estampes créées à l’origine dans un but publicitaire, et en devinrent les thèmes essentiels.

« Défilé des beautés contemporaines des quartiers de plaisirs » (Tôsei yûri bijin awase)
Dans un salon particulier s’ouvrant sur un jardin, un jeune homme nonchalamment allongé sur un futon écoute de la musique en fumant. Des jeunes femmes l’entourent. Les apprêts d’un dîner sont disposés sur des plateaux. Une joueuse de shamisen s’adresse à sa servante qui porte la boîte de rangement de l’instrument.
Ce diptyque fait partie d’une série de vingt et une estampes, dont cinq diptyques consacrés aux quartiers de plaisirs. Kiyonaga a souvent utilisé ce format, créant une mise en scène avec plusieurs personnages, dans un intérieur ou dans un vaste paysage. Son sens de l’espace et de l’équilibre convenait à ces variations sur le thème des loisirs.
Bien que chaque feuille de ce diptyque puisse se regarder isolément, plusieurs éléments concourent à l’unité de l’ensemble : l’attitude des participants et l’orientation de leur regard, le plateau avec la branche de bambou, la véranda et le jardin délimité par la balustrade de bambous. (G. L.)
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
Singulièrement, à travers le style des œuvres transparaît la vision hédoniste de la société des quartiers de plaisirs, son code esthétique élaboré, raffiné, sublimant ses fantasmes. Le thème se fond (se dissout) dans la nouvelle conception des surfaces et du trait en pleins et déliés. Les estampes ukiyo-e, caractérisées par la linéarité du tracé en arabesque, captant le mouvement d’une manière saisissante, la synthèse de la forme inspirée de l’idéogramme, les aplats de couleurs chatoyantes, les compositions asymétriques, décentrées, fragmentées, les vues plongeantes, les angles de vision insolites, les figures mouvantes aux contours ondulants, semblent se faire et se défaire, surgir de la feuille, n’être qu’un fabuleux reflet d’un monde évanescent…
L’origine du terme ukiyo-e
Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d’érable (…), ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c’est ce qui s’appelle ukiyo.
Les amateurs occidentaux d’estampes et de livres japonais étaient nombreux à rechercher, tout d’abord, une émotion esthétique nouvelle. Ils tentèrent cependant de reconstituer l’histoire de cet art, désigné sous le terme ukiyo-e, en sollicitant l’aide des Japonais.
L’un des pionniers fut Edmond de Goncourt, qui publia les premières biographies de deux grands maîtres, sous les titres Outamaro, le peintre des maisons vertes (1891) et Hokousai (1896). Dans l’une de ses lettres au marchand Hayashi, l’écrivain l’interroge sur l’orthographe de l’Ukiyo-e Ruikô, premier ouvrage à réunir des informations biographiques sur les artistes de l’art ukiyo-e, compilé vers 1790, resté manuscrit et complété jusqu’à la version finale qui date de 1868, et imprimé pour la première fois en 1889. Celui-ci lui répond : « Il vaut mieux écrire Oukiyoyé Rouikô bien que cela se décompose en quatre mots ou même cinq mots : Ouki = qui flotte, qui est en mouvement. Yo = monde. Yé = dessin. Roui = même espèce. Kô = recherche. Mais Rouikô est devenu un seul mot qui signifie étude classificatrice ou étude d’ensemble d’une même espèce de choses. » Hayashi revient sur le premier terme et sa signification : « Quant au mot Oukiyoé, nous savons qu’il désigne universellement le dessin de cette école spéciale, connue sous ce nom. Votre traduction, école du monde vivant ou de la vie vivante ou de la vie telle qu’elle se passe sous nos yeux, ou de toutes les choses que nous voyons etc… rend exactement le sens. »

Le présentateur du théâtre Miyako-za
Cette estampe rarissime, classée comme « objet d’importance culturelle » au Japon, est la seule de Sharaku, de format ôban, à figurer un personnage en pied. Cette identification est controversée. L’annonceur serait Shinozuka Uraemon, du théâtre Miyako-za. Celui-ci se détache sur un fond micacé lumineux, vêtu d’un kimono dont le motif décoratif est le caractère kotobuki, qui signifie la longévité. C’est une allusion au titre d’une pièce de jôruri, un brocart couvert de vœux de longue vie, créée par la troupe Miyako-za, en mars 1794. Sur son épaule se détache son emblème (mon), formé d’une feuille de paulownia surmontée de deux éventails croisés.
C’est avec ampleur que l’artiste a dessiné l’annonceur du théâtre, employant pour le visage un graphisme incisif et, pour l’ensemble de la silhouette, un tracé épais et plus synthétique. Sa physionomie, traitée d’une manière caricaturale, joues flasques, rides prononcées, poches sous les yeux, lèvres affaissées, très éloignée des ôkubi-e d’acteurs, révèle un autre aspect du talent de portraitiste de Sharaku, notamment la représentation d’un personnage dans une activité quotidienne.
Curieusement, l’inscription sur le rouleau ne concerne pas le théâtre, mais annonce habilement de nouvelles estampes du maître : « Nous allons maintenant soumettre à votre attention une série de portraits. » (G. L.)
Sharaku ne fit qu’un bref passage dans le monde de l’ukiyo-e, dix mois environ, du cinquième mois de 1794 au deuxième mois dde 1795, d’après les pièces de théâtre qui inspirèrent ses estampes. Son intensité créatrice n’eut d’égale que la fulgurance de son art. Cent quarante œuvres environ, de format ôban, uniquement des portraits d’acteurs célèbres, en plan rapproché ou en pied, nous sont connues.
Cet ensemble présente un caractère étrange, d’une singularité déroutante parmi la production de l’époque. Les visages « désincarnés », pourrait-on dire, des acteurs en gros plan de ses débuts, sur fond micacé gris métallisé souvent, reflètent autant le psychisme de l’interprète que celui du personnage de la pièce.
Viennent ensuite les acteurs, en pied, par deux, œuvres de qualité, puis une centaine d’estampes plus communes, proches parfois de la caricature. Ce changement de style brutal surprend ; certains ont envisagé les contraintes imposées par Tsutaya, qui connaissait des difficultés et aurait souhaité des œuvres plus commerciales.
Aucun document ou presque n’éclaire la biographie de Sharaku. Or, il fut édité par une célébrité de l’édition, Tsutaya Jûzaburô, ce qui prouve qu’il n’en était certainement pas à son coup d’essai, et qu’il devait attirer une certaine clientèle. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains historiens ont tenté de l’identifier à d’autres artistes, à Utamaro par exemple, à un artiste de l’école d’Ôsaka, à Tsutaya même. D’autres y ont vu un peintre qui se serait essayé à l’estampe. La disparition soudaine de cette personnalité énigmatique, n’a cessé d’intriguer. Son influence se perçoit notamment dans des œuvres de Toyokuni, Kunimasa, Shunei...
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France

Coup d’œil furtif (Nozoki)
Utamaro a puisé dans les scènes de la vie quotidienne un grand nombre de thèmes, notamment celui de « la mère à l’enfant ». Coup d’œil furtif fait partie d’une série de onze estampes dont la réalisation s’échelonna sur trois ou quatre ans.
La composition se situe de part et d’autre d’un paravent que le bébé, au premier plan, nous invite à contourner. L’enfant est le point de départ de tout un jeu de correspondances établies sur un cercle. Il désigne du doigt le miroir où se reflète le visage de sa mère qui lui tire la langue. La sœur aînée dissimule un sourire peut-être, derrière la manche de son kimono orné de chrysanthèmes, tout en retenant l’enfant par la lanière de son vêtement.
Les formes et les couleurs se répondent dans cette superbe composition : coiffures vues de face et de dos, superposées verticalement, visages sur un plan oblique, jeu d’écrans entre le miroir et l’uchiwa. À toutes ces lignes courbes qui s’articulent à travers l’espace s’opposent des formes géométriques structurantes, aux contours accentués : rectangle du paravent à décor de gaufrage, cube en laque noire de la coiffeuse, cadre circulaire du miroir. L’ensemble se détache sur un fond gris strié par les différentes pressions et les passages irréguliers du baren lors de l’impression aux effets très recherchés. L’expressivité de l’art d’Utamaro s’apprécie pleinement dans les formes, le volume et le naturel du bébé, magistralement rendu et cela par un simple trait. (G. L.)
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
Il semble que ce soit la première fois qu’un essai d’explication de ce mot, devenu très courant, soit tenté en France. C’est vers 1665 que l’écrivain japonais Asai Ryôi (1612 ? -1691), dans la préface d’un ouvrage, Contes du monde flottant (Ukiyo monogatari), en avait donné un sens plus philosophique : « […] vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d’érable […], ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c’est ce qui s’appelle ukiyo. » Puis le terme apparut, associé à la notion d’image, « e », dans une préface rédigée par Ankei, pour un livre illustré de Hishikawa Moronobu, Images de guerriers japonais (Yamato musha-e), publié vers 1680 : l’artiste, considéré comme le fondateur de l’école ukiyo-e, était qualifié de peintre d’un monde flottant (ukiyo eshi) ; dans un autre livre, cette même année, l’expression « image d’un monde flottant » (ukiyo-e) fut utilisée. Par ailleurs, le dictionnaire Edogaku jiten indique que les premières occurrences du terme ukiyo-e seraient un recueil de haikai de 1681, Sorezoregusa, et la préface d’un livre illustré de Moronobu, de 1682, intitulé Ukiyo-tsuruk.

« En allant admirer les cerisiers en fleurs à KiyomIzu-dô au temple Kan’eiji à Ueno »
À Ueno, site célèbre d’Edo pour les cerisiers en fleurs, sur la galerie d’un temple, une princesse et ses neuf suivantes, admirent le paysage. Les suivantes sont identifiables par leur style de coiffure, celui de la maison d’un seigneur. Kiyomizu-dô est un endroit surélevé, ce qui explique qu’une des jeunes femmes tienne une longue-vue.
Venu d’Occident, cet instrument d’optique, comme le microscope et même les lunettes, se paraît alors au Japon de tous les attraits de l’exotisme.
Une certaine effervescence semble régner dans le groupe, qui a croisé fortuitement un élégant jeune homme, tenant un faucon. Celui-ci descend les marches de la galerie tout en se retournant pour regarder la jeune beauté. Presque tous les regards convergent vers lui. Toyokuni oppose des tons sourds de brun, de rose et d’ivoire à la lumineuse floraison des cerisiers au premier plan, suggérant ainsi la transparence de l’atmosphère printanière. Les couleurs discrètes s’accordent à l’émoi du groupe, à peine perceptible dans l’orientation des regards et le lent ballet des attitudes et des gestes. (G. L.)
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
De l’immuable sacré à l’éphémère de la vie terrestre
Cependant, le caractère uki, issu du monde médiéval, était imprégné de connotations bouddhiques et faisait allusion au monde terrestre des apparences, monde de douleurs, à la condition humaine, misérable, par opposition au monde sacré, immuable. Il sous-entendait la lassitude engendrée par la vie terrestre éphémère. Du sens religieux, uki ne conserva à l’époque d’Edo (1603-1868) que le caractère illusoire, évanescent, superficiel des plaisirs immédiats de la vie quotidienne, et finit par recouvrir une manière d’être hédoniste, faisant du plaisir le principe de la vie.
Le maître de Kambun, actif à Edo à l’ère Kambun (1661-1673), peintre et illustrateur de livres, réalisa des dessins pour les premières gravures ukiyo-e, notamment des érotiques. Il fut à l’origine indirecte du style et du genre de l’ukiyo-e. Après sa disparition, Moronobu (mort en 1694), sensible à son style et formé à deux écoles de peinture, celle de Kanô, de tradition chinoise, caractérisée par la simplification des formes, et celle de Tosa, d’inspiration profane et nationale (Yamato-e), aux contours accentués et aux couleurs somptueuses, devint l’artiste le plus influent à Edo. L’ancienne peinture de genre associée aux nouvelles tendances fut à l’origine de l’ukiyo-e.

Danseuses manipulant les marionnettes à tête de cheval de la danse harukuma du théâtre kabuki
© Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
Les artistes de cette école puisèrent leurs sujets dans le monde contemporain, les activités liées aux divertissements, et s’inspirèrent parfois des thèmes traditionnels, mais sur un mode ludique, reflétant les goûts de la bourgeoisie urbaine de l’époque d’Edo. Les acteurs, les courtisanes, les estampes érotiques, très nombreuses, les scènes de la vie quotidienne envahirent le marché, suivis de très loin par le paysage, qui s’affirma au 19e siècle.
Lien permanent
ark:/12148/mmx6rskr41pw4
